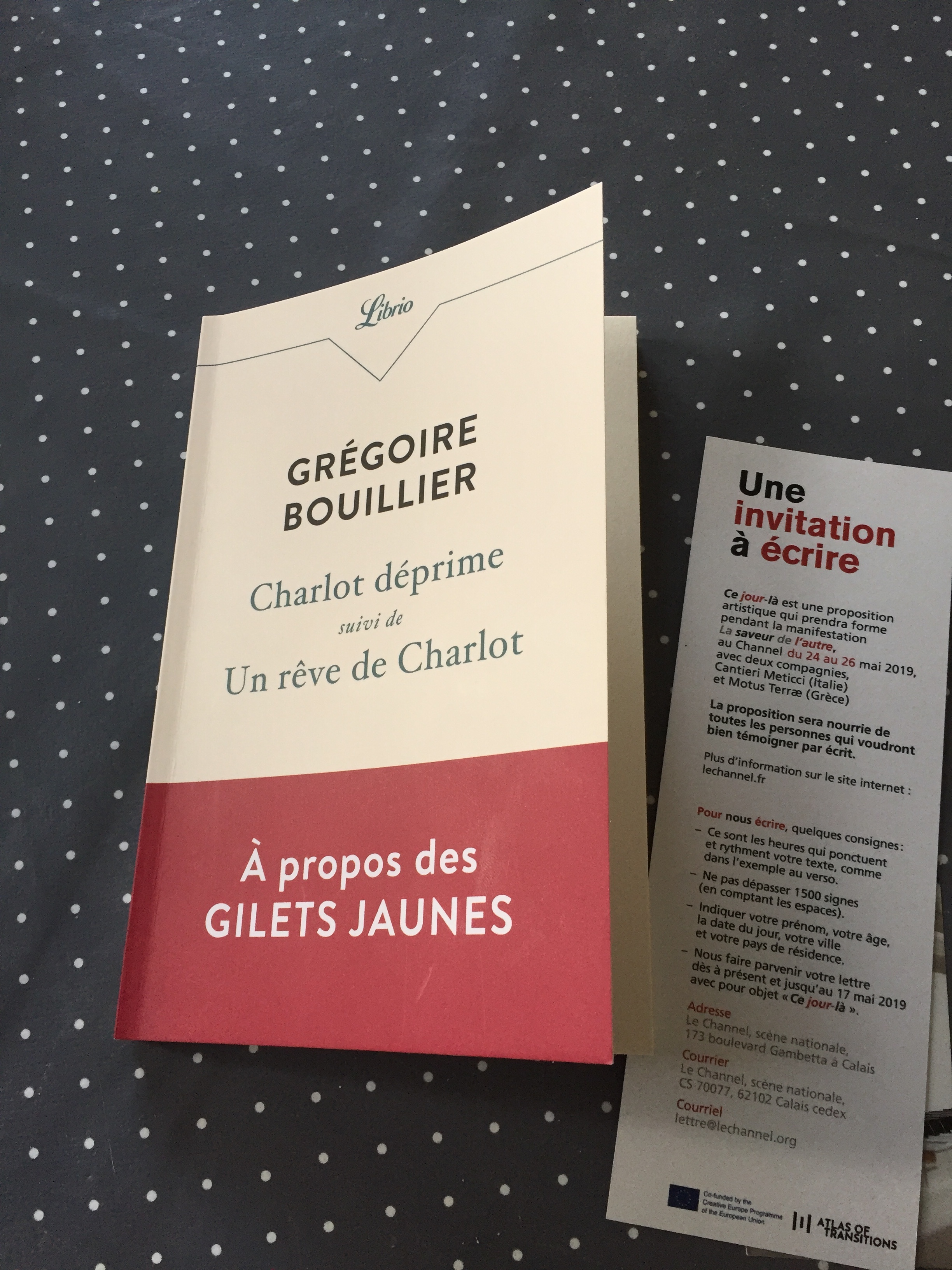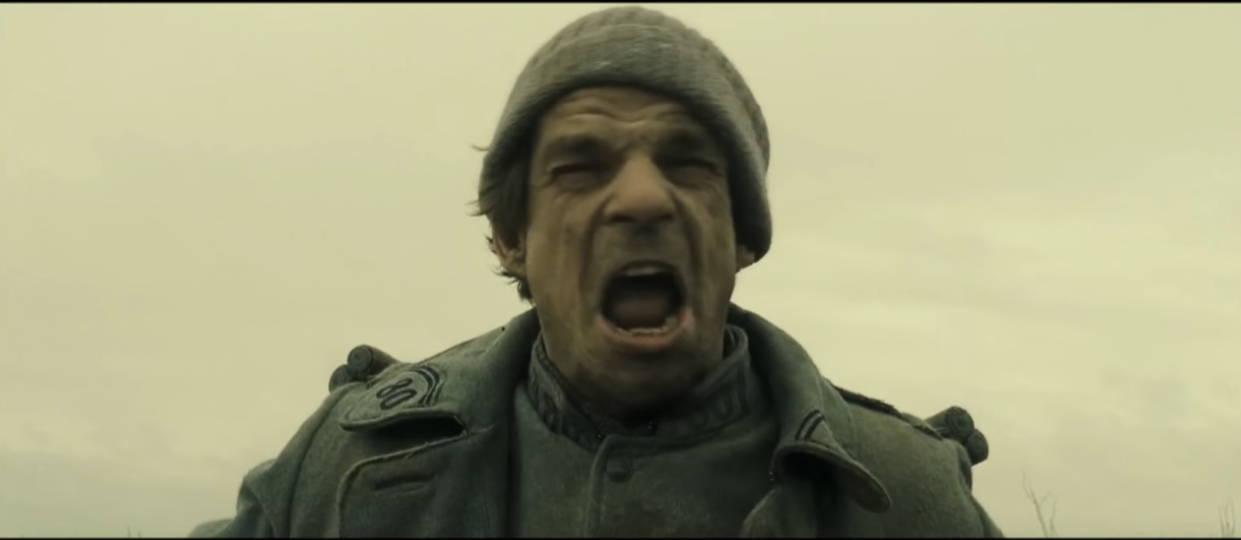Une amie ayant partagé « Hallelujah » de Jeff Buckley ce matin (que je ré-écoute toujours avec autant de plaisir) je repense à la version originale de ce morceau, version longtemps ignorée du public, le morceau ayant connu un premier grand succès public quelques années l’enregistrement de Cohen dans la version de John Cale puis donc la reprise par Jeff Buckley dont je parlais, et enfin, entonné par toute une génération d’ados qui la connaissait par la version qu’en fit Rufus Wainwright pour la BO de Shrek.
J’avais écrit un texte que je vous livre, quant à l’importance de ce titre, quant à sa symbolique et aussi et surtout pour dénoncer certaines « interprétations » très éloignées des intentions de Cohen.
J’adore Cohen, l’homme m’a toujours fasciné et sa trajectoire en tant qu’être humain, croyant parfois, doutant d’autres fois, rejetant ses croyances aussi parfois.
Mais il faut écouter ce morceau pour ce qu’il est, loin des stupidités véhiculées ensuite.
Le mauvais goût fut atteint quelques années après ces succès, transformant le morceau en un genre d’hymne religieux cul-cul avec la reprise par une dinde lors d’un jeu, genre « the voice » sur la BBC, la dinde s’appelait Alexandra Burke et à grands renforts d’effets de voix et de sirop d’arrangement elle alla jusqu’à, comble de l’émotion bon marché, faire pleurer un membre du jury ! (je crois qu’il existe une vidéo de « l’évènement » que vous trouverez facilement si vous cherchez un peu)
Alors j’aimerai vous en dire deux mots de ce morceau, et certes ne pas vous en livrer le sens, nul ne saurait parler pour Cohen, mais en tout cas ce que les allusions bibliques signifient dans la symbolique de Cohen.
En quelques mots, je vais tenter une synthèse de ce que je pense, de ce que j’ai lu, de ce que Cohen en a lui-même dit.
Léonard Cohen a écrit cette chanson en 1980, dans la douleur.
« J’ai rempli deux carnets de notes et je me souviens m’être retrouvé au Royalton Hotel de New York, en sous-vêtements sur la moquette, me cognant la tête sur le sol en me lamentant de ne pas pouvoir finir cette chanson ».
Il vient de fêter ses 50 ans, et à travers le prisme biblique de ce morceau, c’est en réalité un autoportrait en forme de bilan désenchanté dont on peut apercevoir la trame.
Cohen a écrit plus de 80 couplets pour ce morceau, il n’en gardera que 5, John Cale puis Jeff Buckley en reprendront d’autres.
Le tour de force de Hallelujah consiste à entremêler dans un récit psalmodique, références bibliques et interrogations personnelles sur l’écriture de chansons et sur la sexualité.
Cohen part de la légende du roi David qui, selon l’Ancien Testament, jouait de la lyre pour plaire au Seigneur et auquel on attribue l’écriture des Psaumes. Il s’adresse à une femme, lui parlant d’un « accord secret » trouvé par David, mais Cohen ajoute « tu n’aimes pas la musique, n’est-ce pas ? ». Dans le second couplet, il fait allusion à la relation de David et Bethsabée, avec laquelle celui-ci coucha après l’avoir vue prendre un bain, et dont il envoya le mari se faire tuer à la guerre, occasionnant la colère de Dieu qui reprit le fils né de leur union. Puis il enchaîne avec une allusion à cet autre épisode biblique où une femme cause la perte d’un homme, celui de Samson et Dalila (« elle a brisé ton trône, elle t’a coupé les cheveux ») avant d’entrer à pas feutrés dans le cadre ainsi exposé.
Sur les deux derniers couplets, il expie ses propres fautes avant de conclure :
« Et si tout s’est mal passé, je me tiendrai devant le Seigneur des chansons, avec sur les lèvres un simple alléluia. »
Il y a pourtant des failles béantes dans cette première version qui obligent à se garder de toute interprétation trop définitive des intentions originelles de Cohen à travers cette chanson à l’ambiguïté un peu sournoise. C’est sans doute ce qui a chagriné John Cale au moment où celui-ci voulut s’approprier Hallelujah, une demi-douzaine d’années plus tard.
Il contacte alors Leonard Cohen, qui l’autorise à utiliser plusieurs couplets laissés à l’état de friches mais qu’il lui arrive de rajouter au gré des concerts, où la chanson passée inaperçue à sa sortie flamboie d’une aura nouvelle sous les clameurs du public. Avec John Cale, sur ce coup-là, le mot “reprise” semble provenir plus volontiers du verbe repriser que du verbe reprendre. Ainsi remplumé, le morceau prend une autre tournure, nettement plus sexuelle, le profane et le sacré n’ayant jamais si harmonieusement cohabité que dans la poésie sophistiquée de Cohen.
Lorsqu’il s’en empare à son tour, Jeff Buckley exacerbe la version très sobre qu’a livrée John Cale, interprète il est vrai moins sanguin et érotique que le jeune échevelé californien. Pour Buckley, qui gomme sans en demander l’autorisation les vers ayant trait à la rédemption, il ne fait aucun doute qu’Hallelujah est une façon parabolique de parler de l’orgasme, ce que suggère explicitement l’un des couplets rajoutés, où Cohen écrit :
« Je me souviens quand je bougeais en toi, et la colombe sacrée bougeait elle aussi, et chacun de nos souffles était un alléluia. »
Pas très liturgique, n’est-il pas ?
Quant à la dernière strophe, rajoutée elle aussi dans la version Cale/Buckley, elle a de quoi faire s’étrangler les bigots avec l’hostie dont ils pensaient éventuellement accompagner l’écoute de cette chanson aux accents liturgiques.
« Il y a peut-être un Dieu là-haut, s’avance l’auteur à pas désormais nettement moins prudents, mais tout ce que m’a appris l’amour, c’est comment descendre un type qui t’a doublé. Et ce n’est pas une complainte que vous entendez, ni quelque pèlerin qui a vu la lumière, c’est un froid et brisé alléluia.»
Ce n’est pas «Je t’aime, moi non plus», mais quand même, un sacré pavé dans le bénitier que ce Hallelujah 2.0, qu’un tas de fervents a repris en chœur à Noël sans trop prêter attention au caractère furieusement blasphématoire de cette chute.
Avec son entaille à vif portée au sixième des dix commandements (Tu ne tueras point).